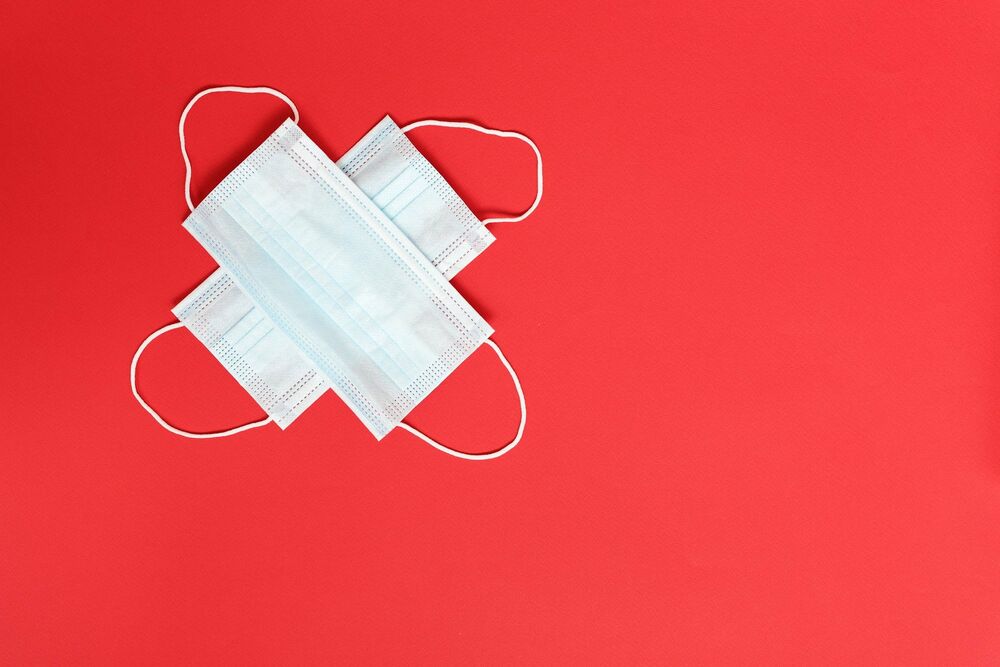Tirée d’un blog intitulé La liberté face à la servitude volontaire, paru le mardi 7 décembre 2021 dans les pages du journal Le Temps et signé Nicolas Jutzet, une phrase a retenu mon attention. Évoquant la crise sanitaire actuelle qui n’en finit pas de finir, et en écho aux dernières décisions du Conseil fédéral, l’auteur constate l’abandon de notre liberté entre les mains de l’État. Contrairement à la plupart des chroniqueurs, il n’accuse pas d’incurie, ni d’impréparation, ni de laxisme, ni d’irresponsabilité, l’État qui ne peut parer toutes les crises – car l’État n’a jamais toutes les données nécessaires.
Nicolas Jutzet accuse non pas l’État mais la société civile. Car, explique-t-il, cet abandon de notre liberté entre les mains de l’État «s’accompagne logiquement d’une croyance (c’est moi qui souligne) que la collectivité est capable de régler les problèmes à notre place.» J’épingle cette expression de «croyance en la collectivité». Car la croyance en la collectivité n’est pas toujours aliénation de la liberté. D’ailleurs, la croyance pourrait aussi bien être en sainte Rita, patronne des causes désespérées, ou en n’importe quelle entité transcendante, plus ou moins personnifiée, le hasard, le destin, ne serait-ce que le temps qui passe (ne dit-on pas avec humour que tout problème laissé en suspens suffisamment longtemps trouve toujours sa solution).
La croyance est un état mental, matrice de perception, d’évaluation et d’action, comme disent les sociologues en désignant ainsi un habitus plus ou moins conscient. Mais quel qu’en soit l’objet (collectivité, État, Dictateur, Président, Dieu, sainte Rita, nature, humanité) une croyance qui n’est pas travaillée par le doute reste stérile et enferme le croyant dans des idées a priori, des schémas de pensée qui interdisent de sentir autre chose que la sensation ou l’image immédiate. Comme disait Jacques Prévert:
«Il s’étonnait de ne pas avancer… et pourtant il suivait son idée. Il est vrai que c’était une idée fixe.»
Cette croyance en forme d’idée fixe se nomme idéologie dans le champ scientifique ou politique: on veut faire entrer la réalité -le peuple, Dieu ou encore l’État en politique- dans l’idée qu’on en a. Ainsi font ceux qui attendent tout du Conseil fédéral ou de l’Exécutif cantonal, comme le dénonce Nicolas Jutzet. Dans le domaine de la gouvernance publique ou d’entreprise, la croyance qui ne veut pas se laisser déplacer par le doute s’appelle technocratie. Enfin dans le domaine religieux, une croyance recherchée comme un lieu de sécurité immobile et qui n’accepte aucune remise en question s’appelle superstition. La superstition prétend pouvoir influencer les entités supranaturelles.
Mais, travaillée par le doute, la croyance prend une dimension plus féconde. Dans le champ scientifique, on parlera d’hypothèse (toujours à vérifier par l’expérience) et non plus d’idéologie; dans le champ de la gouvernance, on parlera non plus de technocratie mais de projet (qui ne va jamais sans problème, c’est la même racine, l’un venant du latin, l’autre du grec); enfin dans le champ religieux, la croyance travaillée par le doute remplace la superstition par la foi qui est toujours attente d’une expérience sensible personnelle (non généralisable).
Si l’on veut avancer, il faut donc remettre en question (c’est ça le doute) toutes les croyances -y compris dans la collectivité, et là je rejoins Nicolas Jutzet et son blog dans Le Temps. Mais, comme pour la marche à pied, on ne peut avancer qu’en acceptant de chuter en avant. Car, remarquent les ergonomes, la marche est une chute perpétuellement amortie.